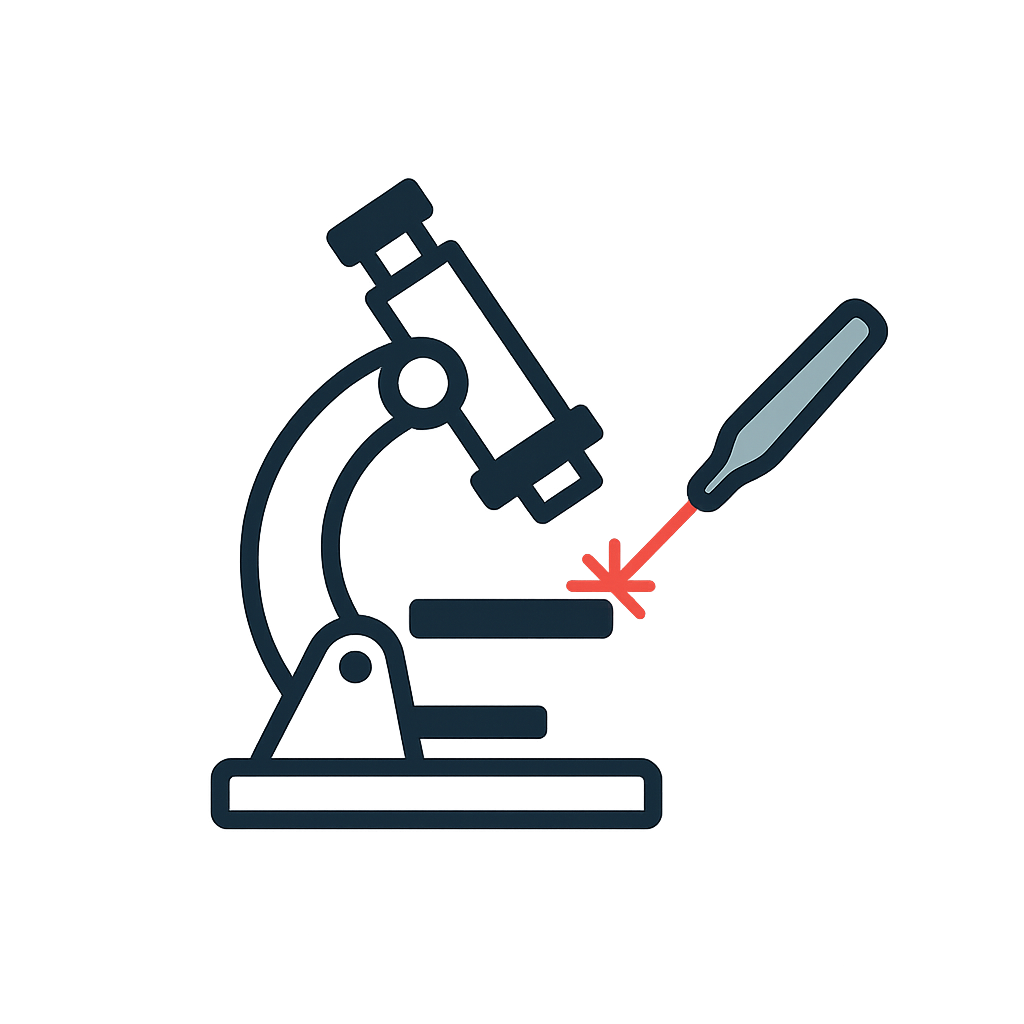Rôle des bactéries anaérobies en clinique humaine.
The rôle of anaerobic bacteria in human clinic
Author links open overlay panel
Yann Dumont 1 2
, Anne-Laure Michon 1
, Chrislène Laurens 1
, Lucas Bonzon 1
, Hélène Jean-Pierre 1
, Sylvain Godreuil 1 2
https://doi.org/10.1016/S1773-035X(18)30253-3
Résumé
L’avènement du séquençage à haut débit et le développement des analyses bio-informatiques ont mis en évidence le rôle majeur et complexe des anaérobies au sein du microbiote humain. La connaissance croissante du rôle de ces bactéries dans des infections graves chez l’homme nécessite d’avoir des laboratoires de microbiologie médicale de plus en plus performants pour le diagnostic clinico-microbiologique de ces pathogènes. De nombreux travaux mettent en exergue le rôle majeur des bactéries anaérobies dans la protection ou dans la promotion de maladies chroniques comme le cancer, les maladies inflammatoire ou encore métabolique. À ce jour, nous ne sommes qu’au début de la compréhension des interactions au sein de ces écosystèmes, où les bactéries anaérobies ont un rôle clef dans ces processus.
Abstract
The advent of high throughput sequencing and development of bioinformatic ana-lyzes has highlighted the major and complex rôle of anaerobes within the human microbiota. The growing knowledge of the rôle of these bacteria in serious infections in humans requires more and more efficient microbiology laboratories for clinico-microbiological diagnosis of these pathogens. Many studies highlight the major rôle of anaerobic bacteria in the protection or promotion of chronic diseases such as cancer, inflammatory or metabolic diseases. To date, we are only at the beginning of understanding the interactions within these ecosystems, where anaerobic bacteria play a key rôle in these processes.
Introduction
Le rôle des bactéries anaérobies dans différentes infections humaines est connu depuis très longtemps. Leur implication dans les processus infectieux a été guidée depuis plus d’un siècle par les principes microbiologiques proposés par Robert Koch à savoir que dans une maladie infectieuse, l’agent étiologique doit être présent et isolé microbiologiquement mais aussi déterminer la même maladie et retrouvé lorsqu’il est introduit dans un nouvel hôte [1]. Dans le cadre de bactéries fastidieuses comme le sont les bactéries anaérobies, l’avènement du séquençage à haut débit et le développement des analyses de métagénomique, ainsi que les nouvelles techniques de culturomique ont mis en évidence le rôle majeur et complexe des anaérobies au sein du microbiote humain [[2], [3]-4]. Ces études ont identifié différents écosystèmes formés par des communautés microbiennes (microbiote cutané, digestif ou vaginal) au sein desquelles existent des interactions permanentes intercommunautaires ainsi qu’avec l’hôte humain [5]. De nombreux travaux com mencent à prouver le rôle central des bactéries anaérobies dans la protection ou dans la promotion de maladies infectieuses, de cancers, de maladies inflammatoires ou encore métaboliques. Cette revue a pour objectif de décrire l’implication des bactéries anaérobies en clinique humaine.
Section snippets
Infection à bactéries anaérobies en clinique humaine
Les bactéries anaérobies font partie intégrante des flores commensales humaines (cutanée ou muqueuses). À l’occasion de traumatismes, de gestes chirurgicaux, de nécrose ou de maladies dégénératives, elles peuvent sortir de leur confinement et provoquer des infections plus ou moins sévères [6,7]. Ces infections les impliquant sont le plus souvent des infections mixtes et leurs sites sont superposables aux sites de colonisation physiologique. Il existe cependant d’authentiques infections
Cancer et bactéries anaérobies
Si aucune association significative n’a pu être établie entre une espèce bactérienne singulière et le cancer colorectal (CCR), la prédominance de certaines bactéries anaérobies présentant des proprié-tés oncogéniques et/ou pro-inflammatoires, a été rapportée chez les patients atteints de CCR comme Bacteroides fragilis ou Fusobacterium nucleatum [19]. Certains isolats de B. fragilis sont capables de pro-duire une toxine de type métalloprotéase dépendante du zinc [[20], [21]-22] fragilysine ou
Conclusion
Avec des connaissances de plus en plus importantes et précises sur la diversité des bactéries anaérobies impliquées à la fois dans le microbiote, mais aussi dans des infections graves chez l’homme, la nécessité d’avoir un laboratoire de microbiologie médicale performant dans le diagnostic clinico-microbiologique de ces pathogènes devient capitale. Dans le même temps, les progrès des technologies de séquençage à haut débit et le développement des analyses bio-informatiques ont permis de mieux
Référence (44)
- NevilleB.A. et al.
- Commensal Koch’s postulates: establishing causation in human microbiota research
- Curr Opin Microbiol
- (2018)
- Mueller-PremruM. et al.
- Performance of two blood culture systems to detect anaerobic bacteria. Is there any difference?
- Anaerobe
- (2017)
- BrookI.
- The rôle of anaerobic bacteria in cutaneous and soft tissue abscesses and infected cysts
- Anaerobe
- (2007)
- BrookI.
- Microbiology and management of joint and bone infections due to anaerobic bacteria
- J Orthop Sci
- (2008)
- BrookI.
- The rôle of anaerobic bacteria in bacteremia
- Anaerobe
- (2010)
- RubinsteinM.R. et al.
- Fusobacterium nucleatum promotes colorectal carcinogenesis by modulating E-cadherin/betacatenin signaling via its FadA adhesin
- Cell Host Microbe
- (2013)
- SetoyamaH. et al.
- Prevention of gut inflammation by Bifidobacterium in dextran sulfate-treated gnotobiotic mice associated with Bacteroides strains isolated from ulcerative colitis patients
- Microbes Infect
- (2003)
- CaniP.D.
- Human gut microbiome: hopes, threats and promises
- Gut
- (2018)
- GuilhotE. et al.
- Methods for culturing anae-robes from human specimen
- Future Microbiol
- (2018)
- LagierJ.C. et al.
- The rebirth of culture in microbiology through the example of culturomics to study human gut micro-biota
- Clin Microbiol Rev
- (2015)
Dental biofilm: Risks, diagnostics and management
Author Rina Rani Ray Current affiliation: Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal, Haringhata, India
Abstract
La cavité buccale est toujours exposée à l'environnement extérieur par l'alimentation et la boisson. La flore normale de la cavité buccale maintient l'ambiance sûre de la cavité buccale. La dysbiose du microbiote buccal, généralement causée par l'intrusion de microbes pathogènes externes, entraîne la formation d'un biofilm sur l'émail dentaire, donnant naissance à la plaque dentaire. La plaque non traitée est suivie de la formation de caries.
De tels biofilms dentaires provoquent non seulement des caries et des pertes dentaires, mais sont également responsables de diverses maladies systémiques, même le cancer.
Parmi les différentes mesures diagnostiques, les réseaux neuronaux et les techniques d'imagerie se révèlent plus pratiques. Les agents pathogènes buccaux peuvent être détectés par analyse métagénomique et séquençage de nouvelle génération. Ces problèmes buccaux peuvent être atténués par le débridement parodontal et l'adoption d'une thérapie guidée par biofilm.
Différents modèles de biofilm artificiel sont proposés pour une étude approfondie de leur mode d'action. L'élimination mécanique du biofilm dentaire par brossage et utilisation régulière de fil dentaire, ainsi que le nettoyage chimique par bain de bouche antimicrobien peuvent prévenir la formation de caries.
L'adoption de mesures thérapeutiques photodynamiques antimicrobiennes pourrait être efficace dans la gestion du biofilm formé sur les dents naturelles ou prothétiques.
Introduction
Les changements de mode de vie, associés à une modification des habitudes alimentaires, affectent considérablement la santé bucco-dentaire. Celle-ci se caractérise principalement par des caries et des infections des gencives associées à des douleurs, voire à la carie et à la perte de dents (Tenelanda-López et al., 2020). Les personnes ayant de mauvaises habitudes alimentaires et une mauvaise hygiène bucco-dentaire souffrent généralement directement de problèmes dentaires. Le profil bucco-dentaire d'une communauté est reflété par l'indice de dents cariées, manquantes et obturées (ODFT) (Organisation mondiale de la Santé, 2020).
La formation de caries est précédée par le développement de la plaque dentaire (Marsh, 2006a, Marsh, 2006b). En bonne santé, le microbiote buccal naturel maintient l'équilibre avec les tissus adjacents et crée un environnement bucco-dentaire sain. Cependant, la déstabilisation de cet état d'équilibre, causée par une infection dentaire, favorise la formation d'un biofilm pathogène composé d'une communauté microbienne composite, entraînant la formation de plaque dentaire. Cette association syntropique de microbes s'accumule rapidement sur la surface dentaire de la couronne, altérant l'aspect brillant naturel et rendant progressivement la plaque facilement visible. Les données indiquent que les dommages causés par la carie sont en réalité causés par l'accumulation de produits métaboliques bactériens sur l'émail de la dent (Caballero et al., 2003).
C'est le début des principales affections dentaires telles que la carie dentaire et la maladie parodontale. La carie dentaire est un processus dynamique où, en présence de sucres fermentescibles, des bactéries cariogènes s'accumulent sur les surfaces dentaires sensibles sous forme de biofilm pathogène.
Sa pathogénicité est attribuée à l'interaction entre le biofilm de plaque dentaire pathogène et la réponse des tissus hôtes (Marsh, 2006a, Marsh, 2006b). Cet état clinique est aggravé par divers facteurs tels qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, les habitudes socio-économiques et culturelles, les pratiques parentales, le dysfonctionnement des glandes salivaires et le patrimoine génétique du sujet (Tungare et Paranjpe, 2021).
Les progrès récents en microbiologie moléculaire ont amélioré les connaissances sur le rôle du biofilm microbien dans la formation de la plaque dentaire. Cela a ouvert de nouveaux domaines de recherche et conduit à de nouvelles avancées en dentisterie. Celles-ci justifient le développement de nouveaux diagnostics et de nouvelles mesures thérapeutiques pour gérer le risque de carie dentaire et, à terme, de perte de dents.
À l'heure actuelle, l'utilisation de l'intelligence artificielle permet de détecter divers organismes formant des biofilms et les mécanismes potentiels permettant de les inhiber (Lahiri et al., 2021). Cette revue décrit la microbiologie du biofilm de plaque dentaire, sa détection, son diagnostic et ses stratégies de gestion.
L'hypersensibilité dentaire .
De nombreux patients souffrent (en silence) de ce problème. La moindre courant d'air, le moindre met un peu froid mais aussi trop sucré, génèrent des douleurs s'étendant sur une ou plusieurs dents voire tout un segment.
Un traitement progressif en plusieurs séances couplées à un traitement parodontal, nous montre selon notre expérience, que le YAP est efficace dans ce cas. Une étude proposée par la faculté de Nice en France semble aller dans notre sens. Le lien est ci dessous.